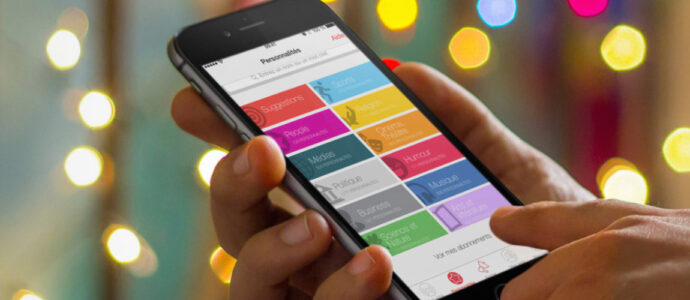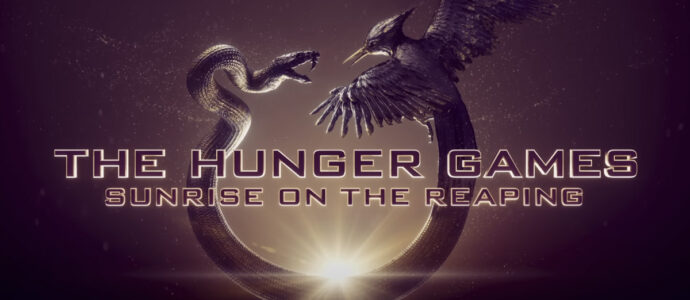Roster Con : Pourquoi avoir décidé de raconter ce drame
personnel ?
Aurélie Drivet : J’ai voulu raconter ce drame
personnel car la mort d’un bébé à la naissance n’est pas seulement
un drame intime qui se joue dans l’isolement d’un huis-clos
familial, c’est aussi un drame collectif qui interroge la
responsabilité de la société et de ses choix politiques, dans un
pays, la France, qui possède le plus fort taux de mortinatalité
d’Europe.
Ce livre cherche en effet des réponses à une question légitime : comment expliquer qu’en France, au XXIe siècle, alors que les progrès scientifiques ont rendu possible la maîtrise de la PMA et la création des utérus artificiels, des bébés en parfaite santé puissent malgré tout perdre la vie à la naissance, en quelques heures seulement, pour des raisons complètement évitables ? Est-ce parce que les protocoles d’accompagnement des grossesses dites « à bas risque » sont insuffisants et qu’il faut les modifier ? Est-ce la cause, plus largement, d’un dysfonctionnement du système de santé, déshumanisé, et qui n’écoute plus la parole des patients ? L’enjeu de ce livre est donc de lancer l’alerte sur la mort des bébés à l’accouchement, qui concerne des milliers de familles par an, en redonnant la parole aux femmes enceintes, trop souvent déconsidérées et infantilisées par le corps obstétrical.
Est-ce que l’écriture a été une forme de thérapie
?
L’écriture m’a permis de trouver des mots pour dire l’indicible,
tout en reconstituant les morceaux d’un moi fragmenté, éparpillé.
En ce sens, oui, elle m’a aidé à mettre de l’ordre dans le chaos.
Penser les maux, par les mots, aide à les panser, d’une certaine
manière. Le souffle des mots, leur rythme, leur structure, m’ont
permis de reprendre mon souffle et de transformer ce scandaleux
désastre, qu’est la mort d’un enfant, en une expérience de beauté
et de vérité. Seule l’écriture permet cette métamorphose : exprimer
une angoisse, un désespoir, « non pour s’en délivrer, mais pour
en changer la nature », comme le dit si bien Malraux, dans sa
préface à Sanctuaire de W. Faulkner.
Mais le livre-thérapie a ses limites, notamment pour la perte d’un enfant. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas vivre avec. Mais c’est un deuil qu’on prend à perpétuité.
Dans votre ouvrage, vous dénoncez notamment un personnel
débordé et des failles dans le protocole médical. Pensez-vous
qu’avec la conjoncture actuelle nous puissions remédier à ces
problèmes ?
La conjoncture actuelle ne justifie pas tout. L’urgence est de
remettre l’humain au centre des soins. Il faut ré-humaniser
l’hôpital. Cela passe d’abord par un nécessaire changement des
mentalités chez le personnel soignant. Les hôpitaux soignent des
maladies, plus que des êtres humains, et c’est bien là le problème
! On fait bien plus confiance aux machines (scanner, échographie,
monitoring) qu’à la parole, souvent déconsidérée, parfois méprisée,
des patients. Les soignants ne doivent pas se comporter comme des
machines. À l’heure actuelle, l’Intelligence Artificielle applique
mieux les protocoles que les humains. Pourtant Google ne soigne
pas.
Mais pour soigner de l’humain, il faut également des moyens humains. L’hôpital est régi désormais par une logique entrepreneuriale : celle de la rentabilité, des enveloppes budgétaires, de l’efficience. Les soignants courent dans tous les sens, on leur demande de faire toujours plus avec toujours moins. La question est de savoir quel système de santé nous voulons défendre aujourd’hui afin de construire la société de demain. Le droit à la santé, comme à l’éducation, sont des droits inaliénables. Pourtant, aujourd’hui, dans une maternité de niveau 3, une maman peut perdre son bébé parce que des soignants manquent de disponibilité pour pouvoir l’accompagner en toute sécurité.
Avez-vous bénéficié d’un suivi dans ledit hôpital suite
au décès de votre enfant ?
J’ai demandé un soutien psychologique dès le lendemain de la perte
de ma fille. Je n’ai pu voir une psychologue que le lundi matin,
soit deux jours après l’accouchement. Je me suis sentie très seule
face à ce drame. Les soignants eux-mêmes semblaient assez démunis,
sous le choc. Les équipes ne sont pas suffisamment préparées pour
accompagner les parents confrontés à la mort d’un bébé.
Après avoir quitté mon lit d’hôpital, je n’ai plus eu aucune nouvelle du centre hospitalier. Silence radio. La porte avait été refermée sur ce qu’ils avaient reconnu comme étant « une terrible tragédie ». Simplement une carte reçue deux mois plus tard pour me rappeler ma visite gynécologique « post-natale ». Une carte que j’ai trouvée très ironique, déplacée, même si bien sûr je savais que ce n’était pas l’intention de l’hôpital. Mais là encore, l’hôpital a un vrai travail à faire dans le suivi individualisé de ses patientes.
Votre témoignage est poignant, émouvant. Cela vous
a-t-il donné envie de continuer à écrire ?
J’écrivais déjà avant la mort de ma fille. Mais après Clotilde,
l’écriture est devenue un besoin, une respiration : je devais faire
revivre mon enfant à travers ma plume. Oui, je vais continuer à
écrire. Un Hiver au printemps est un livre que j’ai voulu poétique
et politique. Je vais continuer à écrire parce que les mots sont
des armes pour venir à bout de l’impossible : ils peuvent faire
revivre une enfant, dans le cœur des lecteurs. Ils peuvent aider,
sinon à faire changer les choses, du moins à ouvrir la porte des
possibles, par la force de la poésie et la beauté du regard qu’on
porte sur la vie.